ACADÉMIE
des Sciences, Agriculture,
Art et Belles-lettres
d'AIX


1ère PAGE
LES RÉSUMÉS
DES COMMUNICATIONS DE L'ACADÉMIE
Rappel des rendez-vous du mois de novembre 2018 :
Mardi 6 novembre, 10 h. cimetière Saint Pierre, mausolée de l’Académie.
17 h. : séance statutaire de rentrée avec élections.
Pot convivial de rentrée, ouvert aux conjoints et aux invités du Bureau.
Mardi 13 Novembre à 17 h.
Jean-Philippe RAVOUX :« Saint Exupéry, philosophe ».
Mardi 20 Novembre 17 h.
Denis COUTAGNE : « Le musée intérieur de Julien Green ».
Mardi 27 Novembre 17 h.
Bertrand MORARD :« Adieu Minerve (Cap Sicié - 27 janvier 1968 - 7 heures, 59 minutes, 27secondes) ».

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 29 mai 2018, Monsieur Jean BONNOIT
a proposé à l’Académie une communication intitulée :
« Sainte Consorce d’Aix-en-Provence, une sainte provençale méconnue... ».
Il était une fois une « statue couverte de poussière, encrassée et appréciée par les insectes xylophages ». Elle était exposée dans la salle Desnuelle, où se réunissait alors le Bureau. Jean Bonnoit, intrigué, s’y est de plus en plus intéressé et au final, sa restauration a été décidée, sous l’autorité du Centre interdisciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine. Nous pouvons désormais l’admirer sous sa cage de verre, dans notre belle salle de réunion. C’est une statue de 93 cm de hauteur sculptée dans une seule pièce de noyer, qui est polychromée et dorée. La sainte est debout, vêtue d’une tunique bleue à bordure dorée et couverte d’un manteau rouge brodé d’or qui enveloppe la tête, drape le corps mais laisse le visage et les mains dégagées. Ses cheveux sont dorés, la main gauche tient une palme, la droite une bobèche et un chapelet est passé autour du poignet droit. Le pied gauche avancé dépasse de la robe longue. Sur le socle, on peut voir le blason de la ville d’Aix, et deux inscriptions : « Sancta Consorcia virgo 1466 » et « Hanc ymaginem fecit Johannes Arnulphi civitas aquensis ».
Ce dont on est sûr, c’est que cette sainte méconnue a existé, mais qui était-elle ? Des recherches très sérieuses et très approfondies ont permis à Jean Bonnoit de lever une partie du mystère.
La tradition locale fait de Consorce la fille de Saint Eucher, né vers 370 et mort en 450 (fils du préfet des Gaules) et de son épouse sainte Galla (riche gauloise) et la sœur de Sainte Tulle, de Saint Véran et de Saint Salonius. Dans le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, il est dit qu’Eucher a deux garçons, qu’il entre au monastère des îles de Lérins, puis qu’il est évêque de Lyon en 434. Aucune mention des deux filles.
En 1890, le vicaire de Saint Rémy dans son ouvrage sur les paroisses du diocèse d’Aix ne cite que les deux filles d’Eucher. En 1843, le docteur Robert évoque un autre Eucher, évêque de Lyon au 6ème siècle, père de Tullia et de Consorce. Après la naissance de ses filles, Eucher se retire dans une grotte située sur un champ appelé Mont Mars et Galla lui sert de servante. Après la mort de Tullia, Galla apprend en songe que sa fille est sainte, que Consorce le deviendra et qu’Eucher sera évêque. Eucher devenu évêque, Galla vit dans la grotte et c’est Consorce qui la sert. Après la mort de ses parents, Consorce construit à Mocton une église dédiée à Saint Etienne et un hospice, fait de larges aumônes et libère ses domestiques. Afin de servir Dieu en demeurant dans la virginité, elle ira demander la protection du roi des Francs. Elle meurt à l’Escale et est ensevelie dans l’oratoire de Saint Etienne.
Il semble qu’il y ait eu deux Eucher : Eucher l’Ancien qui a vécu au 5ème siècle apparaît bien dans la liste des évêques de Lyon et Eucher le Jeune, père de Consorce, évêque de Lyon en 515, mais dont il n’est pas fait mention. On peut supposer que c’est au 9ème siècle que les compilateurs des martyrologues lyonnais ont utilisé pour l’éloge d’Eucher l’Ancien, le texte de la vie de Sainte Consorce. D’où la confusion entre les deux Eucher.
En Haute Savoie au Sappey, l’église du 19ème siècle est dédiée à Sainte Consorce. On y voit la sainte sur une barque venant des îles de Lérins pour accoster à Mandelieu, avec une branche d’olivier et une colombe. C’est reprendre l’histoire d’Eucher l’Ancien qui vers 416 pour fuir les invasions, se réfugie dans les îles de Lérins, avant de s’isoler puis de devenir évêque de Lyon où il meurt en 450.
Une autre hypothèse est celle de Jean-Charles d’Amat : l’église de Sainte Consorce et son tombeau sont situés aux Chaberts dans le territoire de la Théopolis de Dardanus et suggère que Tullia et Consorce sont les filles de Dardanus.
A l’Escale, Sainte Consorce et sa sœur laissent des souvenirs alors que Salonius et Véran sont ignorés. La chapelle Saint Etienne a été détruite en 1962. Dans l’église actuelle, on peut voir un linteau montrant deux colombes buvant au calice et un buste reliquaire de la sainte, un vitrail et une statue récente.
A Cucuron, dans l’église du 13ème siècle, une chapelle est dédiée à Tullia et l’église abrite dans une niche trois bustes reliquaires : ceux de Saint Cyr, Sainte Tulle et Sainte Consorce.
A Beaumont de Pertuis, une statue de Saint Eucher le Jeune se situe à l’entrée du village et une chapelle lui est consacrée dans l’église. Le retable montre Eucher entouré de Galla, Tulle et Consorce. Ce tableau serait de 1650.
A Jouques, dans la nef du Rosaire de l’église Saint Pierre, une toile du 19ème siècle représente Sainte Consorce : elle tient dans sa main un lys, elle est couronnée par un ange et à l’arrière plan, on voit une cruche d’eau car elle est invoquée contre la sécheresse. Tous les ans, le lundi de Pentecôte, un pèlerinage conduit les fidèles jusqu’à la chapelle sur le flanc de la Montagne Concors (déformation de Consorce ?)
Dans un manuscrit du 13ème siècle, propriété de la BNF, une miniature ne représente que Eucher, Galla et leurs deux filles.
Nous sommes dans une période où le culte des reliques est très important. Qu’est-il advenu de celles de Consorce ?
Le chanoine Villevieille nous apprend qu’au 10ème siècle ses reliques ont été transférées à Cluny. Nous n’en avons aucune preuve dans la mesure où l’abbaye a été détruite.
Mais non loin de là, à Berzé-la-Ville, il existait un prieuré rattaché à Cluny depuis 1080. Son seul vestige est la chapelle des moines dont l’abside est très richement décorée. A droite de l’abside, Sainte Consorce porte une croix et emmène le cortège des six vierges sages. C’est la preuve qu’elle fut vénérée à Cluny. Question : qui a osé enlever les reliques ? On peut penser à Saint Mayeul, né à Valensole, près de l’Escale et qui fut le 4ème abbé de 954 à 994. De plus, il existe à l’ouest de Lyon, un village nommé Sainte Consorce et dont l’église possède une relique de la sainte qui aurait été donnée par Cluny. Consorce est la patronne de l’église et une statue récente se trouve à l’entrée du village.
Consorce a vécu au 6ème siècle. Elle est sans doute la fille d’Eucher le Jeune et à la mort de ses parents, elle est une riche héritière occupée à secourir malades et miséreux. Sa réputation fait sa sainteté sur le territoire d’Aix et jusqu’à Cluny. La ville d’Aix ou le Parlement de Provence a offert la statue, propriété de l’Académie, en ex-voto pour la chapelle du mont Concors à Jouques environ 1000 ans après sa mort. Ce don serait lié à une épidémie de peste, au milieu du 15ème siècle. Profanée lors de la Révolution, retrouvée au milieu du 19ème siècle, acquise par la famille d’Albertas puis par Paul Arbaud, elle est devenue notre propriété.
Sainte Consorce aurait-t-elle encore fait un miracle ? On peut se poser la question puisque Jean Bonnoit, professeur de médecine et académicien, est devenu grâce à elle un fin limier et puisque nous aurons un nouveau regard sur sa statue lorsque nous assisterons aux séances du mardi. Grâce à cette belle communication très documentée et avec l’aide de notre sainte, puissions-nous être motivés pour d’autres restaurations !
M.C.


ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres
Le mardi 22 mai 2018, l’Académie a entendu une communication de
Monsieur Jean-Claude GAUTRON intitulée : « Kandinsky ».
Le conférencier a fait rentrer les auditeurs dans l’âme du peintre en utilisant la fiction d’un dialogue au cours duquel l’artiste raconte sa vie. Jeunesse et formation artistique révèlent un tempérament passionné. Après de brillantes études d’économie, Kandinsky découvre la puissance suggestive de la série de toiles peintes par Monet, intitulées Les meules. C’est pour lui une illumination. Il entreprend alors des études d’art à Munich.
Ses premières œuvres représentent des vues de Munich. Peintre de paysages, Kandinsky s’interroge déjà sur la construction de sa représentation tout en montrant sa sensibilité à la lumière et à l’agencement des couleurs, par exemple dans une toile qu’il peint au cours d’un séjour en Hollande : Fauteuils de plage en Hollande. Séparé de sa femme depuis 1902, il vit avec la jeune Gabrielle Münster, son élève, et s’installe avec elle à Paris. Pendant son séjour parisien, Le chant de la Volga et La vie mélangée témoignent de son attachement à la Russie traditionnelle mais aussi de sa volonté d’innovation dans la construction du tableau. Il s’éloigne alors de l’influence réaliste.
C’est à Murnau, au Sud de Munich, où il s’installe en 1908 que Kandinsky, sensible à la relation entre musique et peinture, se détache de la figuration et oriente sa peinture vers l’abstraction en donnant la priorité au rythme et à la couleur qu’il dépose en larges touches sur la toile. Il s’applique à la simplification des formes et des rapports chromatiques, comme dans la toile Improvisation XIV, où des chevaux et des cavaliers semblent surgir des aplats de couleurs jaunes et rouges tandis que l’arrière-plan est occupé par une surface bleue doucement arrondie. En ces années de tension qui précèdent la première guerre mondiale, Kandinsky pense que l’art peut être le véhicule d’un message spirituel. Il l’exprime dans son essai Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier et dans ses œuvres : dans la toile Improvisation XIX, les bleus purs contrastant avec des cernes d’un noir profond traduisent le tragique de l’existence humaine.
La déclaration de guerre conduit Kandinsky à fuir l’Allemagne et à s’installer à Moscou jusqu’en 1921. Il y est très sollicité pour participer à l’avènement de la nouvelle société russe et consacre peu de temps à son œuvre personnelle. En 1922, la proposition faite par Walter Gropius d’un poste de professeur à l’école du Bauhaus de Weimar, donne un nouvel élan à son génie animé par l’idéal de fusion totale de tous les arts. Durant cette période, il subit l’influence des constructivistes russes dans des œuvres telles que Tâche rouge 2 et Sur blanc 2. Il se lie avec le peintre Paul Klee à qui il rend hommage dans sa toile Vers le haut.
A l’automne 33, il peint Développement en brun pour tenter d’exprimer un espoir dans ces temps où la liberté s’amenuise sous la pression du nazisme montant. Contraint de fuir l’Allemagne, il s’installe à Paris. S’éloignant de la rigueur géométrique du Bauhaus, il intègre à ses compositions des formes biomorphiques, peint en lignes souples dans des couleurs chaudes et s’essaie au mélange de sable avec la couleur dans Contraste accompagné. Durant les années de guerre, sa peinture est l’expression d’une aspiration à la sérénité spirituelle dans la recherche de l’équilibre. Ce message est porté avec force par l’œuvre intitulée Accord réciproque, placée près du cercueil de l’artiste à sa mort le 13 décembre 1944.
Le conférencier a satisfait la curiosité de l’auditoire en répondant à de nombreuses questions qui révèlent combien Kandinsky a atteint l’objectif énoncé en 1931 dans Journal des poètes : « être un authentique poète », qui stimule par les formes et les couleurs de ses œuvres toutes les facultés humaines.
N.L.

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 15 mai 2018,
l’Académie a entendu M. Bernard Jouishomme
donner sa communication
Les Indiens des Etats-Unis
Il est communément admis que les Indiens d’Amérique sont originaires des steppes mongoles et qu’ils passèrent de Sibérie en Alaska, à une lointaine époque où le détroit de Behring était couvert d’un manteau de glace. Leur nombre s’élevait à deux millions en Amérique du Nord, avant l’arrivée des Blancs au XVIème siècle. Nomades ou sédentaires, les indiens étaient de remarquables cavaliers. Ils possédaient d’immenses territoires giboyeux où ils chassaient, et sur lesquels les troupeaux de bisons constituaient leur grande richesse. Ils cultivaient le maïs, la pomme de terre, le tabac. Qui n’a en mémoire, instruits par le cinéma ou les bandes dessinées, leur tipee, leur calumet, leur couverture utile pour les signaux de fumée, leur travois et pirogue servant à leurs déplacements, leur visage enduit de couleurs et leur tête coiffée de plumes aux valeurs symboliques ? On n’oublie pas non plus la tradition du scalp et la « Sun Dance », rituel initiatique des jeunes hommes pubères pour éprouver leur virilité. Ces Indiens reconnaissaient l’existence d’un « Grand Esprit », créateur de toutes choses, et vénéraient la terre de leurs ancêtres.
C’est à partir du XVIIème siècle que commence leur déclin. En 1608, le Français Samuel Champlain fonde Québec. L’année suivante, l’Anglais Smith fonde Jamestown, et le Mayflower arrive en 1620 sur la côte américaine avec ses « Pilgrim Fathers ». Tous veulent s’approprier des terres. La rivalité entre Anglais aidés des Iroquois, et Français amis des Hurons, va faire basculer le continent dans une longue guerre sanglante où s’imbriquent luttes tribales, trafics en tous genres, héroïsme et cupidité… Au Traité de Paris en 1763, Louis XV abandonne « quelques arpents de neige ». Et les hostilités reprennent, marquées par la révolte du chef indien Ottaxa Pontiac, celle des Cherokees, la résistance de Shawnee Tecumseh. La répression des Anglais et de la jeune nation américaine est très sévère. Au XIXème siècle, c’est la « guerre des Plaines ». Le Président Jefferson lance la conquête de l’Ouest. Si le Bureau des Affaires Indiennes a accordé en 1824 des droits spécifiques aux minorités indiennes, le Président Jackson signe en 1830 l’Indian Removal Act qui permet de déplacer les Indiens à l’ouest du Mississipi. Sur ce « trail of tears », en français « piste des larmes », des milliers de Cherokees, Sioux, et Navajos, meurent de faim ou de maladie. La rancœur embrase alors le Far West dans d’incessantes guérillas et des affrontements qui culminent de 1860 à 1890. A Little Big Horn en 1876, cinq compagnies du 7ème de Cavalerie du colonel Custer sont anéanties. Mais, en 1890, à Wounded Knee, les Indiens, avec leurs carabines, couteaux, tomawaks, sont décimés par le feu des mitrailleuses Hotchkis. De nouvelles armes, Remington, Winchester et autres, ont aussi favorisé la disparition des bisons, ce qui entraîna la famine et la misère chez les Indiens. Ces carnages ont fait naître des courants philanthropiques pro-indiens, illustrés par le réquisitoire écrasant de l’Américaine H. Jackson, dans son livre Un siècle de déshonneur.
Pendant les deux guerres mondiales, les Indiens participèrent à l‘effort de guerre. Au cours du premier conflit, 14000 d’entre eux servirent dans l’Armée. Durant la guerre du Pacifique, ils furent utilisés pour passer des messages codés. Ronald Reagan et Georges W. Bush ont récompensé ces « Code Talkers ». En 1924, la citoyenneté américaine avait été accordée aux Indiens, et en 1934, l’Indian Reorganization Act du Président Roosevelt avait prétendu leur faciliter la vie.
Depuis 1961, le Red Power ne cesse de les défendre. Cela aboutit, en 2007, à la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones. Les Amérindiens sont enfin reconnus sur leur propre sol, et un accord de dédommagement est voté en 2017 pour résoudre « de façon juste et honorable les griefs historiques des Amérindiens contre les Etats-Unis ». Cependant, les problèmes demeurent avec l’actuel projet d’oléoduc qui devrait traverser la réserve sioux de Standing Rock, dans le Dakota sud.
Aujourd’hui aux Etats-Unis, après un effondrement de leur population, les Indiens sont évalués à 3,2 millions, les Navajos formant le groupe le plus important. Ils accèdent maintenant aux études supérieures et se font un nom en littérature et en politique. Mais l’opposition s’exprime encore dans ces paroles de Sioux : « La Mère Nation est toute puissante…Qu’importe les hommes qui passent ! L’Esprit n’a qu’à souffler sur eux et ils ne seront plus ! »
Cette riche communication, suivie avec beaucoup d’intérêt, pourrait nourrir bien des réflexions d’actualité.
M-C. E

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres
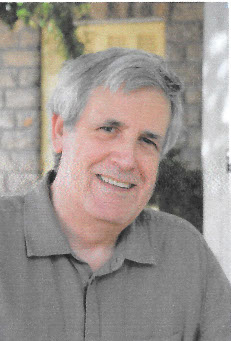
Le mardi 17 avril 2018,
l’Académie a entendu une communication de
Monsieur Jean-Louis CHARRIERE,
intitulée : « L’énigme des stèles d’Entremont ».
Les stèles protohistoriques ont été trouvées lors des fouilles de l’oppidum d’Entremont, capitale du peuple gaulois salyen de 180/175 A.C. à 123 A.C., date de sa prise d’assaut par les Romains. Elles appartiennent à un ensemble remarquable d’environ 500 stèles, découvertes sur le rivage méditerranéen, de l’Aude jusqu’à la Provence. Ce sont des blocs quadrangulaires taillés dans le calcaire tendre de la colline des Pauvres, datés entre le milieu du 9ème siècle et le 5ème siècle A.C. et dont la hauteur varie entre quelques centimètres et 1,50 mètre. Ces blocs, destinés à être plantés dans le sol ou enchâssés, peuvent être ornés de figures plus ou moins schématiques et symboliques et présentent parfois des traces de peinture.
A Entremont, l’inventaire des stèles a suscité quelques controverses. On les a souvent trouvées remployées dans des constructions de bâtiments publics, tours du rempart ou portiques. Fabriquées entre 850 et 500 A.C., elles ont été réutilisées beaucoup plus tard, entre 180 et 90, période d’occupation du site. On s’interroge donc sur ce qu’elles sont devenues entre la date de l’érection et la date de remploi, mais aussi sur les circonstances de leur fabrication puisqu’à Entremont, on n’a aucune trace d’occupation antérieure au IIème siècle A.C. La découverte de plusieurs sites habités au premier âge de fer dans un rayon de 6 à 18 kilomètres incite à conclure qu’Entremont a pu être un sanctuaire commun à ces populations.
Néanmoins, l’incertitude demeure aussi sur leur lieu d’implantation dans le site. Aucune stèle n’a été retrouvée dressée et la mention par Fernand Benoît de cavités qui pourraient avoir été des lieux d’implantation manque de précision. On peut enfin se demander pourquoi ces populations auraient choisi Entremont comme lieu de culte, alors qu’aujourd’hui aucune particularité n’en fait une colline remarquable. On imagine donc que le sanctuaire pouvait avoir été localisé ailleurs, sur le plateau de Bibemus, non loin de la carrière de calcaire qui a servi à la fabrication des stèles, face à la montagne Sainte Victoire et en surplomb de la vaste plaine. On peut aussi conjecturer que les sources thermales, comme à Glanum ou Graveson, jaillissaient en un lieu sacré où les populations adoraient leurs divinités et auraient pu dresser des stèles. On peut, dans ces cas, se demander pour quelles raisons les stèles auraient ensuite été transportées à Entremont.
Enfin, la fonction première de ces blocs reste énigmatique. Depuis le néolithique, des stèles ont été dressées dans un but commémoratif ou votif. Certaines des stèles d’Entremont, gravées de têtes, peuvent être mises en lien avec des textes médiévaux rapportant des traditions guerrières d’origine celte : il s’agissait de conserver en signe de victoire les têtes coupées des chefs ennemis. Ainsi, les stèles figurant des têtes coupées pourraient avoir été des monuments, au sens étymologique du mot, élevés à la gloire du vainqueur ou aussi des ex voto.
Un dernier élément notable garde son mystère : sur le pilier qui comporte douze têtes gravées et sur la stèle aux huit têtes, certaines sont représentées à l’envers. On en ignore le sens symbolique. Pour finir, il faut remarquer que le remploi de ces stèles pose aussi une question sur leur valeur au moment de leur réutilisation. Si certains pensent qu’elles avaient sans doute perdu tout caractère sacré, d’autres sont d’avis qu’elles représentaient les ancêtres et renforçaient, par leur insertion, la valeur du monument. Que penser alors d’une stèle comme celle des deux épis et des seize têtes qui semble avoir été réutilisée deux fois ? Ce bloc témoigne de la complexité de l’histoire et de la signification de ces monuments.
Le conférencier conclut en insistant sur l’immensité du champ de recherche ouvert par les stèles protohistoriques et par les énigmes enfouies dans ce vaste plateau d’Entremont, dont la majeure partie n’est pas fouillée. Les nombreuses questions posées par l’assemblée témoignent de l’intérêt suscité par l’histoire antique de notre ville.
N.L.

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 10 avril 2018,
l’Académie a entendu M. Dominique Mautin
donner sa communication G. Lenotre, une grande « petite histoire ».
Le conférencier a commencé par des alexandrins de son cru et pleins d’esprit, la présentation de G. Lenotre, auteur d’une soixantaine d’ouvrages historiques sur la Révolution et l’Empire. Le « G » de son pseudonyme est l’initiale de Gosselin, son patronyme. Louis Léon Théodore Gosselin est né le 7 octobre 1855 au château de Pépinville près de Metz. Le nom de « Lenotre » vient de son ancêtre André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV.
G. Lenotre débute sa carrière par des chroniques dans Le Figaro, La Revue des deux Mondes, Le monde illustré. Dans le journal Le Temps, paraît Vieilles maisons et vieux papiers, et La petite histoire qui mêle, avec un style anecdotique, grands noms de l’Histoire et personnages secondaires ou inconnus. Cette série-là sera éditée par Grasset. En 1893, Lenotre publie chez Perrin La guillotine et les exécuteurs des arrêts criminels pendant la Révolution « d’après des documents inédits tirés des Archives de l’Etat ». Il est élu en 1932 à l’Académie française, mais n’a pas le temps de prononcer son Discours de réception car il meurt en 1935.
On peut résumer son œuvre par thèmes. Il y a les livres consacrés à la famille royale : La captivité et la mort de Marie-Antoinette, Le drame de Varennes, Le roi Louis XVII et L’énigme du Temple, La fille de Louis XVI, Les fils de Philippe-Egalité pendant la Terreur. Il y a les livres qui relatent les massacres de masse, ceux de Septembre, de la maison des Carmes, des noyades de Nantes. Dans ce sanglant registre, est évoqué le jardin de Picpus, dont la fosse commune reçut les corps de 1306 guillotinés de toute condition sociale. On peut toujours se recueillir dans ce lieu, devenu un des deux cimetières privés de Paris. Le général La Fayette y a sa tombe, annuellement visitée par une délégation américaine. Lenotre fait aussi revivre des « personnages hauts en couleur » comme le chevalier de Maison-Rouge, le baron de Batz, Charrette, la Rouërie, Cadoudal, Robespierre… Il retrace des épisodes de la chouannerie avec La Mirlitantouille ou ceux de la réaction lyonnaise de 1794-1800 avec La Compagnie de Jéhu… Il a encore écrit quelques pièces de théâtre et d’autres diverses œuvres.
Son originalité réside dans sa méthode. « J’ai tenté, dit-il, de faire ce reporter qui a manqué au Paris de la Révolution ; j’ai essayé de pénétrer dans les clubs, à l’Assemblée, dans les cachots, chez les hommes en vue et d’y glaner tout ce que l’histoire a dédaigné, frappé du peu de place que trouvent dans les récits, les descriptions, les décors, les choses. » Il est conscient que l’histoire est écrite par les vainqueurs et que, pour mieux s’approcher de la vérité, il faut aussi chercher la documentation ailleurs que dans les grandes sources officielles. Alors, « il court les villes, les champs, les villages, les études de notaires, les mairies, les châteaux, les presbytères… »
.
Cette manière précise et imagée de raconter l’histoire est devenue un genre qui fut illustré par Alain Decaux et André Castellot, producteurs avec Stellio Lorenzi de la mémorable émission télévisée La caméra explore le temps.
Notre conférencier, invitant son public à lire Lenotre, toujours réédité, conclut en ces vers :
« Lenotre fut le premier de ceux qui ont compris
Que jamais le roman n’aura autant de prix
Que les faits historiques, lorsqu’ils sont racontés
Avec tous les détails de la réalité. »
M-C.E

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres
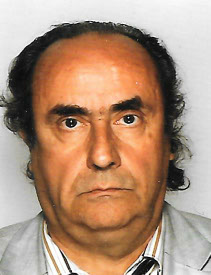
Le mardi 3 avril 2018,
l’Académie a entendu une communication de Monsieur Jean-Louis CHARLET,
intitulée : « Une proposition de censure philologique pour l’édition des textes classiques à Rome sous le pontificat de Paul II (1470) ».
A partir de 1464, Rome devient le premier centre d’impression et d’édition des auteurs latins classiques, avant d’être supplantée par Venise. En 1470, Andrea Bussi, évêque d’Aleria, publie L’Histoire naturelle de Pline l’Ancien. Or, cet auteur est un des favoris de Niccolo Perotti qui aurait bien aimé en faire l’édition et réagit par une critique : c’est la Lettre à Guarnieri, qui ouvre une intrigue que le conférencier nous narre en cinq actes.
Niccolo Perotti, espère obtenir de Guarnieri, secrétaire du cardinal Barbo, neveu du pape vénitien Paul II, l’établissement à Rome d’une censure philologique afin de vérifier la qualité scientifique des éditions, avant l’imprimatur. Perotti pense que les mauvaises éditions portent atteinte aux belles lettres et que les coupables sont les faux savants qui corrompent les textes. Il pose six règles que les éditeurs devraient respecter. Il souhaite que le pape nomme une ou deux personnes pour contrôler l’exactitude du texte de toutes les éditions préparées à Rome avant d’en autoriser l’impression. Il a relevé dans Bussi vingt-deux erreurs et met en avant le seul désir de vérité, car il ne peut laisser mutiler un auteur aussi remarquable que Pline. A la mort du pape en 1471, Perotti doit se contenter d’un poste d’éditeur scientifique.
La Lettre de Perotti circule dans les milieux humanistes vénitiens. Un certain Cornelio Vitelli affirme que Perotti a corrigé avec soin les fautes de la préface de Pline mais que, emporté dans sa rage contre Bussi, il a, lui aussi, commis des fautes de jugement ou d’interprétation. S’il les relève, ce n’est pas pour dénigrer Perotti ou pour se faire valoir mais pour montrer sa bonne foi.
Fin 1481-début 1482, Vitelli remonte au créneau et défend Pline en publiant, à Venise, une plaquette donnant le texte de la lettre de Perotti et sa réplique. Vitelli espère toujours faire une carrière universitaire sur le territoire vénitien et veut se faire valoir en se donnant le beau rôle dans une polémique avec un personnage célèbre, Perotti, qui ne peut plus lui répondre puisqu’il est mort !
En 1489, le grand œuvre de Perotti, la Corne d’abondance, est publié à Venise. Pour une troisième édition de l’œuvre, Antonio Moreto décide d’ajouter en appendice la lettre de Perotti. Mais, pour se mettre en valeur, il se l’adresse en remplaçant le nom de Guarnieri par le sien, et en substituant Venise à Rome. Il assure ainsi à la lettre falsifiée une portée générale et une diffusion dans toute l’Europe.
En 1499, l’imprimeur Manuce démasque la supercherie de Moreto, rétablit la référence à Rome et le nom de Guarnieri. Cette rectification sera alors adoptée par toutes les éditions de l’œuvre de Perotti.
Cette communication a permis de suivre un épisode des débuts de l’impression des textes classiques à Rome, puis à Venise et en Europe, avec une proposition de censure philologique, une proposition de règles à suivre et le premier commentaire humaniste sur Pline. Cette intrigue née de la lettre écrite par Perotti a duré une vingtaine d’années. Des siècles plus tard, la communauté scientifique s’y est intéressée et en 2003, Jean-Louis Charlet a donné la première édition scientifique du texte voulu par Perotti, accompagné de la réplique de Vitelli, en les replaçant dans l’histoire de la controverse sur Pline. Un commentaire illustre ce qu’il appelle « la philologie biologique ». Cette communication très savante nous a présenté un monde d’intrigues, mais était-il si différent du nôtre ?
M.C.

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Mardi 26 mars 2018, l’Académie a entendu M. Jean-Marie Roux donner sa communication : "L’extraordinaire aventure du chemin de fer du Yunnan."
Sur la voie reliant Haiphong (Vietnam) au Yunnan (Chine), le tronçon chinois de Lao-Kay à Yunnan Sen, aujourd’hui Kunming, est la plus extraordinaire des réalisations ferroviaires françaises. En 1885, la Chine autorise la construction d’un chemin de fer sur ses terres, à partir du Tonkin devenu depuis peu protectorat français. Une telle entreprise, dans une région montagneuse périlleuse, suscite bien des réticences en France, mais le projet est approuvé en 1901. Sur 160 km le long de la vallée du Nam, la ligne partant de Lao-Kay à 90 mètres d’altitude, s’élève jusqu’à 1708 m au Col de Milati. La réalisation de cette section sera très meurtrière. Elle comporte quatre-vingt tunnels, le fameux viaduc en dentelle, et le non moins célèbre pont sur arbalétrier. Après avoir encore passé un col à 2012 m, cette ligne arrive à Yunnan-Sen, à 1900 m. Au total, son trajet est jalonné de 3422 ouvrages d’art, dont 153 tunnels et 34 gares. 60000 travailleurs, majoritairement chinois, ont participé à cette œuvre gigantesque. 12 000 hommes y ont perdu la vie. 2000 Européens y furent également engagés.
Albert Marie, un français, célibataire, conducteur de travaux, nous a laissé une correspondance. Nous apprenons qu’il a sous ses ordres 1000 à 1800 coolies, 90 maçons, 100 tailleurs de pierres. IL doit faire, chaque jour, trois heures de cheval pour rejoindre son chantier, affrontant pendant six mois de l’année pluies torrentielles, fleuves en crue, moustiques… A ces conditions climatiques éprouvantes, s’ajoute la nécessité pour lui de maintenir la discipline. Il lui arrive de condamner des travailleurs chinois ou annamites, coupables de divers délits, aux coups de bambous. Mais cela n’a rien à voir, dit-il, avec les sanctions données par les mandarins (torture, amputation, peine de mort), auxquels il a rarement recours. Certains français, mariés, sont accompagnés de leur famille. On essaye alors de reconstituer, tant bien que mal, la vie de la patrie lointaine…
La ligne est mise en service en 1910 et restera pour le Yunnan le seul lien vers l’extérieur jusqu’en 1950. Elle se modernise au fil des ans et reçoit même en 1935 un autorail Michelin sur pneus de 15 places, ce qui ramène le temps de parcours depuis Haiphong à 24 heures. Le trafic de marchandises est assez élevé. Mais sabotages, attaques de voyageurs et d’agents de la Compagnie, rendent l’exploitation difficile. Le chemin de fer aura deux conséquences : l’une positive sur le plan économique et commercial, l’autre négative, annoncée par le consul Auguste François, pour qui nous allions favoriser « à nos frais l’envahisseur possible et probable de notre Indochine ». En effet, les cheminots, ayant acquis une conscience nationale et ouvrière, vont apporter leur soutien au Parti Nationaliste Vietnamien fondé en 1927, et au Parti Communiste fondé en 1930. Le long de la ligne vont se développer alors cellules de combat, distribution de tracts, trafic d’armes… Tout cela fait dire à l’universitaire Anh Tuan Cam : « le chemin de fer a fait le commerce et la révolution ». Il a en effet facilité en 1945, le coup de force d’Hô Chi Minh, proclamant la République Démocratique du Vietnam.
Malgré ce retournement pour les ambitions françaises, la ligne est devenue aujourd’hui un élément essentiel du patrimoine chinois. En 2010 à Kunming, on a célébré avec faste le centenaire de son inauguration. En 2013, la Chine a demandé son classement au patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O. En 2014, le musée de Kunming présente la célèbre Micheline, et les deux bâtiments de ce musée sont même reliés par une réplique du pont arbalétrier.
L’auditoire, agréablement dépaysé, a suivi avec un vif intérêt le récit des grandeurs et malheurs d’une aventure asiatique menée par la France dont la Chine a su reconnaître le beau génie bâtisseur.
M-C.E

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 20 mars 2018, l’Académie a entendu une communication de
Monsieur Hirotaka OGURA,
intitulée : « Qu’est-ce que le théâtre : évocation poétique ou action dramatique ? ».
Quelques extraits de séquences filmées du théâtre nô et du théâtre classique français nous font entrer dans le vif du sujet.
Le nô, né fin 13ème siècle et perfectionné au 15ème, est considéré comme la forme théâtrale la plus ancienne du monde. Le nô est ennuyeux à faire dormir certains, et pourtant, il attire de nombreux spectateurs : à raison d’une représentation par jour à Osaka et Kyoto et de deux à Tokyo, 20 000 spectateurs remplissent chaque mois les nôgakudô, salles conçues pour ce spectacle. Comment expliquer ce paradoxe ? Claudel disait : « le drame, c’est quelque chose qui arrive, le nô c’est quelqu’un qui arrive ».
Les effets recherchés pour focaliser l’attention sur le personnage principal et la primauté des mouvements corporels sur l’action dramatique, exigent de l’interprète une formation technique exceptionnelle. Aller au théâtre nô, c’est assister à une performance artistique stylisée et raffinée et non suivre une action dramatique. Or, le nô a évolué en 600 ans tout en présentant toujours les mêmes pièces. Le rythme actuel est de plus en plus lent et la durée d’une pièce est deux à trois fois plus longue qu’à l’origine. Le ralentissement va de pair avec une interprétation de plus en plus raffinée et un mouvement rythmé par des tambours où chaque parole est chantée. Cette évolution élitiste marque l’abandon progressif de l’aspect dramatique. Le nô devient un lieu de réflexion esthétique et morale qui transmet le patrimoine culturel du Moyen Age japonais. Le classicisme du nô attire un public jeune, suppose un effort intellectuel et le jour viendra sans doute où il ne pourra être apprécié que par des adeptes ayant reçu une sorte d’initiation. Si l’on s’y ennuie, c’est par incompétence intellectuelle.
Quant à la tragédie française de l’époque humaniste et classique, elle est abordée à travers une pièce écrite par Jean de La Taille en 1572 : Saül le Furieux, récit biblique. Le chœur qui intervient dans l’action joue le rôle du spectateur à l’intérieur de l’espace théâtral. La gestuelle des acteurs est stylisée puisque l’action est commentée par le chœur. Ce théâtre fondé sur des évocations poétiques rappelle la théâtralité spécifique du nô. A la fin du 16ème siècle, les tragédies amputées de leur chœur ne retiennent que les parties dramatiques. Le public s’intéresse à l’action et à ses péripéties. S’opposent alors, les partisans de la tragédie parlée et de la tragédie lyrique, il y a donc hésitation entre action et évocation.
Le nô a poussé son aspect poétique à l’extrême, la tragédie française a opté pour l’action. Ces deux constituants essentiels du théâtre nous montrent que le théâtre n’est pas un art de musée mais une activité vivante qui doit tenir compte des attentes différentes des spectateurs. La mise en parallèle du nô et du théâtre classique français a donné lieu à une communication savante, illustrée par des citations, et qui a permis à l’assemblée de poser de nombreuses questions. M. Ogura, membre correspondant de l’Académie et professeur à l’université Sofia de Tokyo, a voulu, une fois encore, ouvrir nos esprits occidentaux aux arcanes du pays du Soleil levant.
M.C.

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 13 mars 2018,
l’Académie a tenu une séance publique solennelle pour la réception comme membre titulaire de M. Jean-Pierre Centi
au fauteuil du professeur Roger Bout décédé en 2016.
M. Centi a retracé, devant une assemblée émue, le parcours exemplaire de son prédécesseur qui fut son parrain académique, avec M. les docteurs Jacques Lafon et Jean-Jacques Sacco. Né à Villeneuve-lès-Avignon en 1939, Roger Bout fit ses études supérieures à la Faculté de droit et à l’Institut d’Etudes politiques d’Aix-en-Provence. Agrégé de Droit privé et de Sciences Criminelles, il fut d’abord nommé à la faculté d’Alger avant de revenir à celle d’Aix, où des générations d’étudiants se formèrent à son enseignement exceptionnel. Durant ces années aux multiples activités, Roger Bout rédigea avec le professeur Gérard Cas le Lamy Droit économique, ouvrage de référence qu’il ne cessa jamais d’actualiser. Marié, père de famille et grand-père, l’homme, élégant, grand sportif, passionné de théâtre et d’art, était engagé au service d’autrui et dans la défense de l’institution familiale. Sa personnalité rayonnante a profondément marqué la vie de l’Académie dont il a été trois fois président.
Dans sa réponse, le docteur Jacques Lafon a présenté le récipiendaire M. Jean-Pierre Centi. Né en 1945, à Sousse en Tunisie, dans une famille d’origine italienne qui partagea le sort des Français obligés de rentrer en France après la crise de Bizerte en 1963, Jean-Pierre Centi termine ses études secondaires à Toulouse et à Marseille. Puis, c’est la faculté de Droit et Sciences Economiques d’Aix où, professeur agrégé d’économie, il exercera jusqu’à sa retraite en 2013. Il fut Doyen de la faculté d’Economie Appliquée de 2002 à 2012. Impliqué durant sa carrière, dans la coordination du programme Erasmus, la direction du Centre d’Analyse Economique, celle du Journal des Economistes et des Etudes humaines, celle de la Société du Mont Pèlerin, et dans maint autre organisme, M. Centi est un spécialiste reconnu des questions monétaires. L’Académie a déjà profité de toute cette richesse grâce aux nombreuses communications qu’il lui a présentées. Elle se réjouit d’accueillir comme membre titulaire un brillant économiste, capable aussi de gravir les pentes de Sainte-Victoire avec ses étudiants, et de cultiver avec bonheur l’art d’être grand-père.
M-C.E

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 20 février 2018
Madame Danielle IANCOU-AGOU
a proposé à l’Académie une communication intitulée :
« Récit croisé de la vie d’un couple singulier, miroir de l’épopée des juifs et néophytes provençaux à la fin du Moyen-Age ».
Les archives départementales des Bouches-du-Rhône, chez les notaires d’Aix, ont permis à la conférencière de découvrir un mariage juif, daté du 25 juin 1469, celui de Régine Abram et de Bonet de Lattes. Cette union de courte durée, deux ans et demi, l’intrigue et l’incite à s’intéresser au parcours de ces deux personnes.
Régine, fille d’un riche médecin de Draguignan, est promise à un Aixois, Bonet de Lattes. Le contrat matrimonial rédigé en latin est enregistré chez un notaire chrétien mais fait référence à un contrat passé devant un appareil juif. Sa dot est somptueuse : 2 000 florins (1200 en espèces, 800 pour le trousseau). Or, en 1472, Régine est devenue Catherine. Pourquoi ? Elle a quitté avec fracas ce mari choisi par son père et, convertie de force, neofita, elle s’est remariée en janvier 1472, à l’église Sainte Marie Madeleine, avec Gillet Gilibert, secrétaire du roi René et écuyer des cuisines royales. Cet homme sera dénoncé par le roi pour avoir pratiqué des conversions forcées. La dot passe de l’ex-mari juif au nouveau mari.
Veuve du second mari en 1479, elle épouse en 1495, un juriste, Etienne Jean. L’année suivante, pour cause de « mésentente, ire et zizanie », c’est la séparation de corps et de biens et, s’estimant, « seule, sans famille, ni amis » (parents, frère et une sœur décédés), elle envisage de léguer ses biens à un quatrième individu, Simon Nas. Avec lui, ce sera une union libre. Ils auront deux enfants et ne se marieront qu’au soir de leur vie en 1517, le troisième mari étant décédé en 1512. C’est l’histoire d’une femme, qui a eu quatre maris, un juif et trois chrétiens, qui meurent tous avant elle.
Son père, son frère et ses sœurs sont des convertis. Sa sœur Guillemette de Villages est mariée à un néophyte de Saint Maximin, filleul du roi René et anobli en 1469. Une autre sœur Charlotte est mariée à une filleule de la reine et du duc de Calabre. Ces trois femmes bien nées dans l’aristocratie juive de la Provence orientale ont dû être sollicitées par la Cour du roi René. Sous son règne, les juifs connaissent clémence et protection monnayée, alors que dans le royaume de France, ils n’ont plus le droit de cité depuis 1394. Le roi René condamnait les conversions forcées mais ne répugnait pas à parrainer les convertis !
Qu’est devenu son premier mari, Bonet de Lattes ? Il a d’abord dû restituer la dot. Installé à Arles, il y refait sa vie, a deux enfants qui noueront des unions au sein de l’élite juive de la Cité pontificale. Devenu médecin en 1476 puis dirigeant communautaire, il s’occupe de prêts et de petit négoce. Dans les années 1488-89, il liquide ses biens, se défait de sa maison, de sa vigne et récupère ses créances à Marseille. Il est en instance de départ. Son choix se porte sur l’Italie et on le retrouve à Rome en 1493 dans le milieu de la Cour pontificale, comme médecin du pape Alexandre Borgia VI. Il est devenu un personnage considéré. Il est le rabbin de sa communauté et d’un noyau de juifs français et provençaux. Il invente l’anneau astronomique qui fera sa renommée. Il disparaît en 1510.
Le récit croisé de la vie de ces deux personnes, unies un temps très court, ayant des chemins très distincts mais proches tous deux des milieux de Cour aixois ou pontifical, reflète l’épopée des juifs et néophytes de cette époque. En effet, le rattachement de la Provence au royaume de France met en péril les quelques 2000 juifs qui y vivent. Leur choix sera pour une moitié de partir et pour l’autre moitié de se convertir, prenant de nouvelles identités empruntées à des parrains chrétiens prestigieux. Des années de recherches dans les archives locales ont permis d’enrichir l’histoire de la Provence du roi René, ce qui ne pouvait qu’intéresser notre Compagnie.
M.C.

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 13 février 2018,
l’académie a entendu M. Paul Djondang donner sa communication
« Mondialisation et emploi : malus en France, bonus ailleurs ? »
Comment expliquer chez certains Français la défiance pour la mondialisation et la tentation d’un repli protectionniste ?
La mondialisation présente une dimension commerciale, financière, technologique, industrielle et géopolitique. Elle a cherché à élargir les marchés, à inciter entreprises et Etat à investir, à augmenter la productivité et les salaires réels. Depuis les années 1990, la croissance économique mondiale a bel et bien été tirée par l’essor des Pays Emergents, mais cela a été perturbé par la crise financière de 2008-2009.
La mondialisation était sensée réduire le pouvoir des monopoles, élargir l’offre de biens et de services. Cependant, l’ouverture des secteurs stratégiques, notamment du textile, a été politiquement difficile. Dans les Pays Moins Développés, la mondialisation a visé la hausse des salaires pour les employés de qualification faible ou moyenne. Dans les Pays Avancés les productions exigeantes en travail qualifié ont été encouragées. Mais on assiste à une « popularisation des emplois » généralisée. Dans les Pays Riches, les emplois hautement et faiblement qualifiés augmentent, pendant que les emplois moyennement qualifiés baissent. Dans les Pays Moins Développés, ce sont surtout les emplois faiblement ou moyennement qualifiés qui se développent …
Quant à la France, quelles sont ses performances par rapport aux grandes régions du monde ? Dans le domaine de l’emploi, elles sont parmi les plus faibles des pays de l’OCDE, depuis la crise de 2008. Le chômage français ne serait dû à la concurrence des pays à bas salaires que dans une proportion de l’ordre de 8%. Les chocs de l’ouverture économique française proviennent surtout de la concurrence des autres Pays Industrialisés, ce qui se traduit par un déficit commercial bilatéral substantiel avec ces partenaires, et par une désindustrialisation plus accentuée en France qu’en Europe.
D’après l’INSEE, le marché du travail français semble plus perturbé par des signaux sociétaux et de politique économique intérieure que par le coût du travail ou la concurrence extérieure. L’insuffisante mobilité des chercheurs d’emploi dans ce pays apparaît également comme un handicap. Enfin, l’économie nationale ne s’est suffisamment pas adaptée au contexte de la mondialisation actuelle. En particulier le nombre insuffisant d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), dont le rôle dans les secteurs les plus dynamiques est essentiel, constitue un frein pour la compétitivité du système productif français.
En fait, la défiance des Français pour la mondialisation pourrait venir plus profondément de leur préférence quasi instinctive pour « la règle » plutôt que pour « la convention ». La règle découle de procédures centralisées et s’impose à tous, quelle que soit la variété des situations de terrain. La convention s’établit de manière décentralisée et souple, pour s’adapter aux inévitables contextes locaux, ce qui n’empêche pas de respecter un certain cadrage national.
Le conférencier invite les décideurs publics et les économistes à se pencher sur cette dernière considération, qu’il a néanmoins soumise au préalable à la vive attention des académiciens aixois !
M-C.E

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 6 février 2018,
L’Académie a entendu une communication de
Monsieur Albert GIRAUD,
intitulée : « Xénophon d’Athènes, Fortuné de Brack, officiers de cavalerie ».
A plus de 20 siècles de distance, ces deux personnages ont en commun le fait d’avoir rédigé des manuels destinés aux officiers de cavalerie. Xénophon (430-355 avant JC) écrit de nombreux ouvrages de philosophie, politique, éducation, économie, histoire mais sa vraie vocation est l’état militaire. Il rédige deux traités : De l’équitation et Du commandement de la cavalerie. Né en 1789, Fortuné de Brack, engagé à 16 ans dans l’armée impériale, participe à toutes les campagnes napoléoniennes. Il rédige en 1831 Avant-postes de cavalerie légère, manuel destiné aux jeunes officiers, et qui fait encore autorité de nos jours. Le conférencier précise au préalable qu’il n’existe qu’une cavalerie : la cavalerie légère, et que les meilleurs cavaliers sont ceux qui sont nés à cheval comme les Parthes ou les Cosaques.
Xénophon et de Brack se complètent puisqu’ils traitent du même sujet : le combat à cheval. Ils veulent répondre dans leurs ouvrages aux questions que se posent les jeunes officiers.
Le choix du cheval est primordial : taille moyenne, rein court, encolure forte puisqu’il doit supporter le cavalier et son équipement. A Athènes, le soldat est un citoyen qui s’équipe à ses frais, ce qui suppose qu’il est recruté dans les classes les plus riches. Le cavalier de l’Empire est aussi un citoyen, mais ses armes lui sont offertes par l’Etat. Ces cavaliers suscitent admiration et crainte. Quelles sont les solutions pour monter sur le cheval : sauter à cheval, se faire aider, dresser le cheval à s’agenouiller ? Comment être stable ? Le cavalier athénien s’installe sur une couverture attachée par une sangle. Pour le cavalier du Moyen-Age, c’est l’arçon en bois portant les étriers et recouvert de cuir. La selle assure au cavalier moderne la stabilité, réduit le risque de tomber et permet d’utiliser les armes avec plus de force. Comment être protégé et rester agile ? Pour le cavalier antique, le cuir recouvert parfois d’écailles métalliques, pour le cavalier d’Empire, un uniforme couvert de brandebourgs qui peuvent amortir des coups de sabre.
Les armes varient en fonction de l’époque et des circonstances. Le premier cavalier léger est un archer : on sait que le Parthe peut tirer au galop sur un adversaire. La lance est une arme redoutable dont les blessures sont mortelles. Le sabre est l’arme préférée du cavalier antique comme du cavalier moderne car c’est une arme facile à porter et à manier. La carabine est difficile à recharger au combat. Le pistolet doit être protégé de l’humidité et n’est découvert qu’au moment du combat. La crainte du cavalier est de perdre son arme.
La tactique de la cavalerie reste fondée sur les mêmes principes quelle que soit l’époque. Les unités de cavalerie ne sont jamais au milieu du corps de bataille mais devant, sur les côtés ou en arrière. Le combat de cavalerie fait penser à la charge, au choc des cavaliers emportés par la vitesse. Mais en réalité, les cavaliers n’ont aucune chance face aux fantassins formés en ligne ou en carré. La première mission de la cavalerie est le renseignement : rapporter des informations sur l’ennemi, sa nature et ses intentions. La cavalerie assure l’avant-garde et couvre les flancs des grandes unités. Son atout c’est toujours la rapidité, la surprise, la ruse. Tous les ordres sont transmis au son de la trompette.
Xénophon et de Brack consacrent de longs développements à l’art de commander, c'est-à-dire se faire obéir, se faire suivre et se faire aimer. La première qualité d’un vrai cavalier est l’humilité : monter à cheval est une épreuve de vérité, on ne peut tricher. L’officier doit savoir faire tout ce qu’il commande. La dureté est inutile, les punitions révèlent plutôt l’incapacité du chef. Le moteur, c’est l’émulation.
Dans sa conclusion, le conférencier insiste sur la notion d’héritage, mot qui convient à l’esprit de la cavalerie, qui est né du lien entre l’homme et le cheval et qui a traversé les siècles. « Quel que soit le sort que l’avenir nous réserve, il y aura toujours une cavalerie dont le rôle sera de reconnaître, couvrir, combattre, poursuivre, qui trouvera le succès dans l’audace, la vitesse, la surprise, en un mot, qui fera preuve d’esprit cavalier ». Cette communication a permis à l’assemblée d’enrichir ses connaissances sur l’art de la cavalerie et a montré l’enthousiasme et l’admiration de l’auteur pour cet art.
M.C.

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 30 janvier 2018,
l’Académie a entendu M. Pierre Nalin
donner sa communication
Giraud, Guizot, Thiers et les autres : itinéraires d’un académicien aixois.
Le conférencier évoque surtout son aïeul Charles Giraud, né à Pernes-les-Fontaines en 1802, dans une ancienne famille de notaires. Diplômé de la Faculté de Droit d’Aix où il se lie d’amitié avec Adolphe Thiers et François Mignet, Charles Giraud fut Président de l’Académie d’Aix à 36 ans. Il y prononça un discours mémorable, intitulé Du caractère de la civilisation et des doctrines politiques chez les anciens et les modernes.
Sous Guizot, Charles Giraud entretint des rapports professionnels durables avec Prosper Mérimée, Inspecteur Général des Monuments Historiques, à qui il fit visiter le site celto-ligure d’Entremont. Mérimée commente : « L’absence de médailles, d’instruments de bronze, de tuiles, la grossièreté des poteries et la maladresse des sculptures, tout dénote une époque de barbarie et un peuple voisin de l’état sauvage » ! Un budget est malgré tout libéré pour lancer les fouilles. En 1835, Giraud obtient la chaire de Droit administratif à Aix. Ses compétences vont permettre à la ville de conserver la propriété de la bibliothèque Méjanes.
En 1842, notre Aixois s’installe à Paris parce qu’il est élu membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques. Il y fera plus de 220 communications. Il collabore aussi avec Louis-Philippe, roi des Français, pour la rédaction du Traité d’Utrecht (1847). Guizot lui écrit à ce sujet : « Sa Majesté me recommande de vous dire, Monsieur, qu’elle est enchantée de votre travail ». Mais en 1848, c’est la fin de la Monarchie de juillet… Sous la Seconde République, Charles Giraud sera deux fois ministre de l’Instruction publique et des cultes. Il demande alors aux élèves de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm de décliner toute invitation officielle aux bals, fussent-ils « de l’Hôtel de ville » : « L’autorité même de la profession à laquelle ils se destinent et le travail sérieux qui leur est imposé ne permettent guère ce genre de distractions ». Mais sa plus spectaculaire décision est d’interdire de cours Jules Michelet, au Collège de France. Conseiller d’Etat sous Napoléon III, Charles Giraud vote contre la dépossession des biens de la famille d’Orléans. Cela lui vaut sa révocation. Il reprend alors sa chaire de Droit romain à la Faculté de Paris. Cette fin politique est accompagnée de malheureuses spéculations sur les forges d’Herserange en Belgique qui forcent Giraud à vendre sa précieuse bibliothèque. Généreux, l’Empereur aidera son ex-ministre à rembourser ses dettes.
Plus tard, Charles Giraud fréquente le salon de la princesse Mathilde où il rencontre toutes les célébrités de l’époque, Sainte-Beuve, Théophile Gautier, Victor Cousin, Renan, Flaubert, Viollet-le-Duc, les Goncourt… Malgré son veuvage en 1867, Giraud continue de rendre les invitations chez lui où, selon Charles de Goncourt, il lui arrive de servir « un dîner tout provençal commençant par la bouillabaisse, en passant par la brandade et en finissant par l’aïoli » ! Le siège de Paris en 1870 met fin à ces mondanités. Thiers écrase la Commune et permet à la Princesse, avec le soutien de Giraud, de rentrer en France. Flaubert regrette de n’avoir pas reçu l’ancien Aixois chez lui à Croisset, et Guizot lui demande un avis favorable de l’Institut pour son prochain livre. Quant à Mignet, il s’émerveille d’un cadeau de Charles Giraud à Jules Simon, Président du Conseil : « Donner un Cicéron de Robert Estienne en deux volumes in folio, maroquin rouge, fleurdelisé, c’est faire un magnifique présent. Le rendre à son ancien possesseur qui l’avait vendu, en accompagnant cette gracieuse restitution d’une phrase latine si spirituellement tournée et si classiquement écrite, c’est d’une exquise munificence ». Le 14 mai 1881, Charles Giraud donne son ultime cours à l’Ecole de Droit et s’éteint le 13 Juillet, sans avoir voulu revoir son ami François Mignet, qui pourtant venait tous les jours prendre de ses nouvelles.
En 1885, Ernest Renan écrit à la Princesse Mathilde, leur amie commune : « J’aimais beaucoup Giraud. Sa franche, fine et honnête nature, sa gaité si pleine de philosophie me plaisait infiniment ».
Notre conférencier ne pouvait trouver meilleure conclusion à cette riche vie qui fait briller par un sourire final la générosité du soleil provençal.
M-C.E

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 23 janvier 2018,
l’Académie a entendu Monsieur Philippe Malburet
donner sa conférence,
La représentation du ciel depuis Anticythère jusqu‘au planétarium moderne.
L’homme a toujours cherché à représenter la voûte céleste et ses extraordinaires mouvements d’horlogerie. C’est après de multiples tentatives au fil des âges que le mécanisme d’Anticythère aboutit au planétarium moderne.
D’après Cicéron, Archimède (287-212 av JC) avait déjà réalisé une sphère représentant le mouvement des astres. Mais la découverte, au début du XXème siècle à proximité de l’île grecque d’Anticythère, d’une épave datant de 87 avant JC, nous intéresse particulièrement. On en remonta un mystérieux mécanisme aux engrenages taillés dans le métal, et dont le nombre de dents sont des références astronomiques indubitables. Il peut donc être considéré comme un des tout premiers planétariums, bien que les discussions savantes à son sujet ne soient pas closes.
Après Galilée (1610), de nombreux « planétaires » furent proposés. Citons les « orreries » de Charles Boyle, 4ème comte d’Orrery, en Irlande. Ou encore, le globe de Gottof à l’intérieur duquel il était possible de pénétrer pour voir le ciel. Cet objet se trouve au musée Lomonossov de Saint-Pétersbourg. Au 18ème siècle, sur le plafond d’une maison de la ville de Franeker, aux Pays-Bas, le néerlandais Eisinga représenta les planètes du système solaire connues à cette époque. Elles étaient actionnées selon les lois du cosmos par un mécanisme complexe. Au début du XXème siècle, aux Etats-Unis, c’est la construction du globe d’Atwood, mû par un moteur électrique. Sa surface percée d’environ 700 trous permet de faire apparaître ou disparaître les planètes. Des masques de différentes formes figurent les phases de la lune. Cette merveille est visible au musée de l’Académie des Sciences, à Chicago.
Enfin, après avoir hésité entre le planétarium « copernicien » et le planétarium « ptolémaïque », les ingénieurs conçurent le planétarium moderne. En 1923, recréant « le silence majestueux de la nature », un premier prototype fut construit sur le toit du Deutsches Museum de Munich. La technologie évoluant, on utilise maintenant les LED, la fibre optique, et des logiciels pour simuler les divers mouvements de la sphère céleste. Certains simulateurs sont même entièrement numériques. L’ordinateur produit une image qui peut être projetée grâce à plusieurs vidéoprojecteurs répartis en périphérie ou au centre…
On se déplace ainsi instantanément en tout lieu de la terre pour y voir le ciel correspondant, ou on s’évade dans d’imaginaires voyages interstellaires ! Mais le système « hybride » est la meilleure solution : le ciel est produit par un simulateur optomécanique et toutes les projections annexes se font grâce à un système numérique. C’est ce qui équipera bientôt le Planétarium Peiresc d’Aix-en-Provence et sa coupole de huit mètres.
En France, le premier planétarium fut acquis pour l’Exposition Universelle de 1937. Il est installé dans l’actuel Palais de la Découverte. A partir des années 1980, les planétariums se sont multipliés sur notre territoire. On en compte aujourd’hui une centaine.
L’auditoire captivé a apprécié l’excellente pédagogie de l’orateur qui lui a rendu accessibles toutes ces choses un peu techniques. Qu’il en soit remercié !
M-C. E

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 16 janvier 2018,
l’Académie a entendu une communication de
Monsieur Bernard MATHIEU,
intitulée : « L’affaire du Freinet (9ème -10ème siècles),
considérations politiques, militaires et religieuses ».
Le territoire des Francs connaît une période très troublée à partir du 8ème siècle. Les Arabes ont conquis le monde méditerranéen et après avoir envahi l’Espagne, ils s’installent en Septimanie. Arrêtés à Poitiers en 732, ils se tournent alors vers la Provence. L’Empire de Charlemagne, divisé par le traité de Verdun en 843, n’a plus les moyens de s’opposer à leurs visées et l’Occident chrétien est confronté à la piraterie sarrasine.
Les Arabes s’engagent dans la création de repaires le long des côtes provençales et occupent à la fin du 9ème siècle tout le massif des Maures. Pillages et dévastations sont d’abord limités à la Provence orientale, alors que la partie occidentale est mieux protégée par des fortifications qui barrent les rives du Rhône. La Provence est un état fictif, divisé par des querelles intestines. Ce n’est qu’en 962 qu’une autorité forte est restaurée avec Otton 1er qui reprend le titre de Imperator Augustus.
A la fin du 9ème siècle, Freinet, en arabe Djebel al Kilal, est occupé et cela va durer 80 ans. Un évènement imprévu va mettre fin à cette occupation. En juillet 972, Mayeul, abbé de Cluny, revient d’un long séjour en Italie et tombe dans une embuscade tendue par les Sarrasins. Une rançon de 1000 livres d’argent est versée contre sa libération qui a lieu le 15 août. Pour venger cet affront fait à la chrétienté, une chasse aux ravisseurs est organisée par tous ceux dont Mayeul est l’ami, le conseiller et l’arbitre : Otton 1er, le pape, tous les seigneurs de Provence dont le comte Guillaume d’Arles. Les coalisés se rendent maîtres du Freinet et de tout le massif. Cette reconquête est alors suivie d’une recomposition de tous les domaines de la Provence orientale.
Les pirates sarrasins sont restés vivants dans la mémoire des Provençaux ce qui est paradoxal, étant donné l’absence d’indices matériels sur une terre occupée pendant des décennies : aucune trace d’habitat, de lieu de culte, de sépulture, de poteries, de murailles ou de tours.
Le comte Guillaume après sa victoire devient le chef incontesté de la féodalité provençale.
Cette communication a eu le mérite d’exposer la complexité de cette époque marquée par des invasions successives et la difficulté d’y faire face tant la situation politique était confuse.
M.C.

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 9 janvier 2018,
l’Académie a entendu une communication de
Monsieur Jean-Louis BERGEL,
intitulée : « Fauves de Provence, Fauves en Provence ».
Le fauvisme est un art de rupture, une révolution artistique contre l’académisme, le néoclassicisme, le symbolisme, l’impressionnisme et le divisionnisme. C’est un art fondé sur la couleur pure, la simplification des formes, le rejet de la perspective. La peinture doit être une représentation des émotions du peintre et non une représentation de la réalité. Ce mouvement, dont le chef de file est Matisse, s’est révélé au Salon d’automne de 1905 où exposaient Matisse, Derain, de Vlaminck, Van Dongen… Ces artistes ont partagé entre 1905 et 1908 une même conception, par des techniques picturales analogues et inédites. La lumière méditerranéenne s’est prêtée naturellement à l’explosion des couleurs.
La Provence, berceau du fauvisme. Les couleurs du Midi ont exalté les talents de nombreux artistes qui y sont nés.
Charles Camoin (1879-1965) est considéré comme le plus impressionniste des Fauves, dont il a évité la violence et les excès. Ses portraits, ses natures mortes et ses paysages sont marqués par l’éclat du Midi, mais aussi par une douceur inconnue des autres fauves.
Seyssaud (1867-1952) est un peintre provençal, installé à Saint Chamas. Reconnu comme un des pionniers de l’art moderne, c’est un coloriste emporté : « il écrase sur sa palette les couleurs les plus ardentes : rouge vif, bleu cru, jaune fulgurant, vert exaspéré qu’il épand avec une énergie brutale ».
Chabaud (1882-1955). Sa vie de noctambule à Paris l’a inspiré davantage que la Provence. Il choisit les thèmes urbains et industriels de la ville lumière plutôt que les paysages : rues chargées d’affiches, vues enfumées de gares, hôtels borgnes, prostituées aux visages ravagés et aux maquillages outranciers. Sa palette est violente : rouges vifs, jaunes éclatants, noirs de jais, blancs purs, bleus métalliques. On lui doit aussi des paysages provençaux plus sobres : bords de mer ou de l’étang de Berre, avec des formes plus stylisées et des couleurs moins vives.
Lombard (1884-1973) est le provençal qui correspond le plus au fauvisme. Il joue sur l’opposition de zones claires et de zones foncées. Pour lui, le fauvisme est la division de la surface du tableau en compartimentages colorés pour aboutir au choc visuel.
La Provence, terre d’accueil des Fauves.
Des artistes comme Braque, Dufy et Friesz ont en premier lieu trouvé le langage de la couleur sur les rivages de la Normandie mais, c’est dans le Midi qu’ils deviennent Fauves.
Braque (1882-1963), inspiré par l’Estaque, schématise les paysages par des jeux de courbes et de droites, et dit adieu au point de fuite, comme dans Le viaduc de l’Estaque. Il construit à la manière de Cézanne et du pointillisme des tableaux comme Embarcadère, Paysage à l’Estaque aux « tons de rose, carmin, vermillon et jaune citron ».
Derain (1880-1954) à l’Estaque, Cassis ou Martigues pousse l’intensité des couleurs. Il s’efforce de simplifier les formes par le choc des couleurs, en neutralisant la profondeur.
Dufy (1877-1953) partage cette volonté de simplification d’abord en Normandie puis à Marseille et à Martigues. Il compose ses toiles par de grands aplats de formes géométriques, de bleus, de verts, de jaunes, de rouges.
D’autres comme Matisse, Marquet, Camoin ou Manguin, en choisissant Saint Tropez pour peindre des paysages, des prostituées, ont fait de cette localité un des foyers du fauvisme.
Pour les Fauves, il fallait se libérer du modèle, détacher le motif de la nature pour en faire le motif du tableau.
Dans sa conclusion, le conférencier rappelle que le fauvisme reste un temps fort de la peinture du 20ème siècle en France et que la Provence occupe une place de choix dans cette épopée. Le règne du fauvisme fut bref mais intense. Il fut une parenthèse contre l’art conventionnel et un trait d’union entre l’art moderne et l’art contemporain. D’ailleurs les Fauves eux-mêmes ont évolué au cours de leur parcours. L’art n’est-il pas toujours fait de continuités et de ruptures ? Passionné par la peinture, Jean-Louis Bergel a offert à l’Académie une belle et riche communication illustrée par la projection de nombreuses œuvres picturales.
M.C.

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 19 décembre
l’Académie a entendu
M. Jacques Maleyran
donner sa communication
1917, l’année qui a changé le monde.
En une remarquable et brillante synthèse, notre conférencier a récapitulé les événements de cette année décisive dont nous achevons de marquer le centenaire.
La première guerre mondiale dure depuis trois ans. 1917, c’est la fin de l’Empire russe et, avec Lénine et Trotski, le début d’une épuration sanglante menée par la Tchéka, futur KGB. 1917 annonce aussi la fin de l’Empire Austro-hongrois, et celle de l’Empire ottoman qui a eu le temps de perpétrer le génocide arménien; c’est encore la déclaration de Lord Balfour qui reconnaît aux Juifs le droit de s’installer en Palestine.
Quant aux Français, ils sont entrés en guerre très conditionnés par les chansons patriotiques. Mais en avril 1917, après les lourdes pertes de l’offensive Nivelle, leur moral est en berne et les mutineries commencent sur le front, rythmées par la Chanson de Craonne. Sur 412 condamnations à mort, 55 seront exécutées. Le général Pétain, à son tour nommé au commandement, décide d’économiser les hommes et de réorganiser l’armée. De leur côté, les Anglais menés par le général Douglas Haig et soutenus par les tanks, se battent héroïquement à Vimy, Messines, Passchendaele en Flandre.
Le 2 avril, les Etats-Unis sont entrés en guerre contre l’Allemagne, et vont envoyer deux millions de soldats en Europe, des armes, des dollars. La guerre devient alors vraiment industrielle.
En 1917, l’Histoire à venir se prépare aussi. Le caporal Adolf Hitler forge dans les tranchées ses funestes pensées qu’il communiquera à un autre combattant de la grande guerre, l’aviateur Hermann Goering. L’ex-leader socialiste Mussolini, blessé au combat, clame sa rage après la défaite italienne de Caporetto, et mûrit son idéologie de dictateur fasciste. Le député Winston Churchill mobilise toute l’industrie britannique pour la fabrication d’armes, et l’américain Franklin Roosevelt encourage l’effort de guerre. Tous deux joueront un rôle déterminant dans la victoire des alliés, pendant la seconde guerre mondiale.
Le capitaine Charles de Gaulle, prisonnier des Allemands, trois fois évadé, trois fois repris, médite sur les bouleversements du présent : « L’avenir sera peut-être à nous » dit-il de façon prémonitoire. De son côté, Mao Tsé Toung entame à 23 ans sa « longue marche », qui ne se fera pas sans victimes. Et dans l’enfer des hommes, se lève un indien pacifiste, le Mahatma Gandhi, dont l’action non-violente aboutira à l’indépendance de son pays, l’Inde.
Après cette vertigineuse galerie de portraits où se sont mêlés semeurs de Mal et artisans de Paix, le conférencier a conclu en rappelant que 1917 fut aussi l’année de la création de la coupe de France de Football, du premier match entre la France et les All Blacks qui nous écrasent par 40 à 0, de L’homme et son désir de Darius Milhaud, de la Rhapsodie nègre de Francis Poulenc, de l’heure d’été, de l’apparition de la Vierge à Fatima au Portugal… et le 31 décembre à Brest, du premier débarquement du jazz en Europe.
L’auditoire, ému par les rappels tragiques de 1917, a su gré au conférencier de terminer plus légèrement par des notes de musique cette fin d’année 2017.
M-C.E

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 12 décembre 2017,
l’Académie a entendu une communication de
Madame Lucienne Ditto-Bozetto,
intitulée : « Chagall, les écrits ».
Moïche Zakharovitch Chagalov : Marc Chagall né en Russie, à Vitebsk en 1887, mort à Saint Paul de Vence en 1985.
La peinture de Chagall entretient un rapport étroit avec l’écrit.
L’écrit dans le tableau
Il rencontre la relation texte-image dans des lubki, les icônes. Des écritures diverses prennent place dans ses tableaux. Au plafond de l’Opéra de Paris, des inscriptions sont un hommage à Mozart, Ravel, Brahms et à d’autres musiciens et danseurs. Chagall a appris à lire dans la Torah et dans quelques textes hassidiques, et les récits entendus parlent de la vie propre des lettres hébraïques qui se fiancent, se marient… L’écrit c’est d’abord sa signature, c’est aussi le nom de sa ville natale, Vitebsk, écrit en hébreu et en lettres dansantes. L’utilisation de l’hébreu a une dimension religieuse et affirme son origine « Je n’aurais pas été artiste si je n’étais pas juif ». Il construit les éléments d’un tableau en forme de lettre hébraïque : le « double portrait à l’éventail » en forme de gimel, « au-dessus de la ville » en forme d’aleph, « l’homme qui marche » en forme de aïn. Des mots peuvent apparaître avec des variantes : dans l’étoile de David qui est derrière le Juif de « La prisée », une fois est écrit Vie, une autre fois Mort. Chagall disait « il ne faut pas chercher à comprendre ».
Il intègre l’écrit qu’il rencontre dans le shtetl (quartier, village). A « l’entrée du cimetière juif de Vitebsk » de 1917, des versets d’Ezéchiel proclament l’espérance mais Chagall en a modifié un mot : dans la prophétie, est promis le retour sur le « sol d’Israël » alors que lui, écrit « Eretz Israël », espoir d’un pays neuf. Dans « le Juif en rouge », le texte semble pleuvoir sur l’homme mais les lettres hébraïques montent du sol, elles sont un appel à se lever. Chagall a peint de nombreuses crucifixions dont « La grande Crucifixion blanche », 1938, où ce qui est écrit en hébreu et en latin provoque de véritables scandales et lui vaudra d’être accusé de blasphèmes par certains juifs orthodoxes. Le crucifié est au centre des drames de l’histoire, entre les soviets et les nazis. Ce peintre juif peint une représentation chrétienne mais le linge autour des reins du crucifié est un châle de prière, un talit, à ses pieds brille une hanoukiah, mais au-dessus de sa tête on peut lire INRI, Jésus le Nazaréen le roi des Juifs. Ces trois écrits bibliques parlent d’ouverture, un des traits constants de Chagall : ouverture vers le pays neuf, ouverture et départ pour aller vers soi-même et ouverture vers une autre religion. Pour Chagall, « la plus grande source de poésie de tous les temps a toujours été la Bible ». Il a offert à la lettre hébraïque une place qu’elle n’avait jamais eue et l’a donnée à lire.
L’écriture des livres.
Les écrits de Marc et Bella Chagall lient étroitement écriture et peinture.
Ma vie, son autobiographie, commencée en 1921. L’invention est constante, l’imaginaire nourrit l’écriture. Chagall recrée des atmosphères. C’est l’enfance et la jeunesse à Vitebsk, les parents, la famille, la communauté, la ville marquée par la présence de la cathédrale. C’est Paris en 1910 et la découverte d’esthétiques qui le séduisent ou le révulsent. C’est en 1914, le retour en Russie et son mariage avec Bella. Ma vie est aussi un livre d’histoire : le tsar, la guerre avec les blessés et les prisonniers, la révolution de 1917 qui donne aux Juifs l’égalité des droits et fait de lui le « commissaire du peuple pour les arts » à Vitebsk, puis son rejet des soviets qui le ramène à Paris. Sa vie est aussi le refus de tous les –ismes : « à bas, le naturalisme, l’impressionnisme et le cubisme réaliste ! ». Pour lui, écriture et peinture relèvent du même élan et procèdent des mêmes choix esthétiques. Il exprime ce qui lui tient à cœur : passion de l’art et de la liberté, attachement à sa judéïté, à l’amour de Bella, à sa culture, à sa ville, à la Russie.
Lumières allumées, Première rencontre, un écrit de Bella qui évoque son enfance, le monde de Vitebsk, les fêtes juives, l’atmosphère de la ville et de la maison. Sa poétique est de même nature que celle de Chagall puisqu’ils ont en commun le culte, la culture et l’imaginaire hassidiques.
Il existe aussi des écrits moins connus de Chagall, poèmes écrits en yiddish ou en russe. On y trouve, l’espérance de 1917, le pays neuf, la nostalgie, mais aussi les sources de consolation : Jacob, Moïse, David qui sortent de la Bible pour marcher à ses côtés et les visages de Bella, l’unique, et de Vava, sa seconde épouse. Ce sont des poèmes-prières mais aussi des actions de grâce.
Quelques écrits sur Chagall

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 5 décembre 2017,
l’Académie a entendu
M. Bernard Guastalla
donner sa communication
Le petit tambour d’Arcole (1777-1837).
En rappelant les grands moments de l’épopée napoléonienne, le conférencier a fait revivre ce jeune héros provençal dont la statue orne la place de son village natal Cadenet, et dont la fine silhouette se profile, parmi les gloires de l’Histoire de France, sur les fresques de l’Arc de Triomphe et du Panthéon.
A l’état civil, il s’appelle André Estienne et s’engage dans l’Armée des volontaires du Luberon en 1792, à 14 ans. Avec ce bataillon mal formé et peu discipliné, il participe d’abord à une expédition en Sardaigne qui tourne au fiasco, puis avec l’armée du midi à une guerre de montagne, dans le comté de Nice et les Alpes, qui préserve la France d’une invasion par le Sud. Notre héros s’initie alors aux diverses batteries de son tambour et apprend à devenir un transmetteur d’ordre. En mars 1796, Bonaparte est nommé commandant en chef de l’armée d’Italie composée de soldats « nus et mal nourris ». Estienne, tambour des chasseurs à pied de la garde des Consuls, en fait partie et c’est à Arcole, face aux Autrichiens, le 16 novembre 1796, qu’il gagne son titre de gloire. « Il passa le canal à la nage, sous le feu de l’ennemi, battit la charge, et donna à ses camarades l’exemple de l’intrépidité » Pour sa « bravoure éclatante », Bonaparte, premier consul de la République, lui décerne « à titre de récompense nationale, des baguettes d’honneur (à manches et à pointes d’argent) ».
La veille, essayant d’entraîner ses hommes avec le drapeau de la 51ème demi brigade à la main, Bonaparte avait glissé dans le marais avec son cheval, mais il fut heureusement secouru par ses grenadiers. L’iconographie ne retiendra que l’image du général Bonaparte, le drapeau à la main, s’élançant sur le pont d’Arcole, ayant à ses côtés le tambour Estienne !
Celui-ci continue de s’illustrer, avec l’armée du Rhin, le 27 juin 1800, à la
bataille d’Auberhausen. Toujours volontaire, André Estienne franchit, de nouveau à la nage, le Danube à Günzbourg. En 1804, aux Invalides, il est décoré de la croix de la Légion d’Honneur par Napoléon qui lui aurait dit en se souvenant d’Arcole : « Je me rappelle de toi. J’aurais soin de toi ». Lors du sacre de l’Empereur, le 2 décembre de la même année, Estienne est le seul tambour à être retenu pour battre dans la nef de N-D de Paris. Un an plus tard, jour pour jour, à Austerlitz, il livre dans les rangs de la garde impériale sa dernière bataille contre les troupes austro-russes.
En 1806, après 14 ans de service, le tambour prend sa retraite, fonde une famille, connait des difficultés financières qui s’atténuent sous Louis-Philippe, grâce à la protection du père d’Alfred de Musset. Il peut encore vivre de paisibles années, jusqu’à sa mort le 29 décembre 1837, à l’âge de soixante ans. Une foule importante, des officiers supérieurs de Légion, une députation maçonnique, un détachement de la Garde Nationale, lui rendent les derniers hommages. Mais la femme et la fille du héros d’Arcole se retrouvent dans l’indigence.
A Cadenet, sa statue, inaugurée en 1894, fut démontée par de courageux cadenétiens pendant la deuxième guerre mondiale pour être soustraite à la convoitise de l’occupant allemand. Elle fut remise en place le 7 octobre 1945. Nous pouvons toujours aller l’admirer et nous souvenir avec émotion de la glorieuse histoire du
« petit tambour d’Arcole », que nous a si bien contée notre conférencier.
M-C. E


Le mardi 21 novembre 2017,
l’Académie a entendu une communication de
Madame Marcelle MAHASELLA,
intitulée : « Les recueils d’Albert Camus : des Essais aux Nouvelles ».
Camus a écrit des textes courts et condensés, essais puis nouvelles qu’il a rassemblés en recueils. Ses premières publications peuvent être considérées comme les gammes de l’écrivain, le prélude aux œuvres de la maturité.
La conférencière a proposé une analyse de chacune des œuvres en les illustrant par des citations empruntées à Camus et à quelques critiques littéraires.
1937, L’Envers et l’Endroit regroupe cinq essais : L’Ironie, Entre oui et non, La Mort dans l’âme, Amour de vivre, l’Envers et l’Endroit. Les thématiques camusiennes y sont claires : « Ce qui compte, ce sont les hommes ». Pour Camus, les difficultés que sont pauvreté, maladie, peur de l’inconnu révèlent l’homme dans sa vérité : « Je sais que ma source est dans ce monde de pauvreté et de lumière où j’ai longtemps vécu ».
1939, le recueil Noces compte quatre essais : Noces à Tipasa (invitation à la vie : amour et sensualité à travers les odeurs, la caresse du vent, les couleurs, la beauté du lieu), Le vent à Djemila (règne de la mort, repli sur soi), L’Eté à Alger, Le Désert (osmose entre l’homme et la nature).
1954 L’Eté comprend huit textes : Le Minotaure ou La Halte d’Oran (Oran ville fermée et Alger ville ouverte, deux villes opposées et complémentaires) , Les Amandiers, Prométhée aux enfers, Petit guide pour des villes sans passé, qui réaffirme l’opposition entre Alger et Oran, L’Exil d’Hélène, L’Enigme, Retour à Tipasa, La Mer au plus près. Un recueil où alternent mythologie et vécu, passé et présent, ville et nature, Méditerranée et Atlantique car l’homme et le monde sont riches de cet ensemble.
1957 L’Exil et le royaume regroupe six textes qui sont autant de réflexions sur la solitude, la solidarité, le cheminement vers l’ouverture aux autres et vers l’amour. La femme adultère, Le Renégat, Les Muets (souvenirs d’enfance, difficulté de communication entre le monde ouvrier et le patronat), L’Hôte (est-ce celui qui reçoit ou celui qui est reçu ?, mise en évidence de deux mondes qui se côtoient mais ne se mêlent pas), Jonas ou l’artiste au travail et La pierre qui pousse.
En conclusion, la conférencière précise que ces recueils proposent les mêmes interrogations, les mêmes réponses, et les mêmes thèmes que ceux qui seront développés dans les textes majeurs : l’absurde, la révolte, l’engagement, la solidarité, la recherche de l’unité et de la beauté. Depuis l’exil de la naissance qui projette l’homme solitaire sur la terre ce n’est que dans le partage des douleurs et des joies communes avec les hommes comme avec la nature que ce dernier peut trouver des possibles pour tendre vers le royaume. Camus revendique avec force ce royaume fragile : « Je suis heureux dans ce monde car mon royaume est de ce monde ».
Cette communication, dite avec enthousiasme, a mis en évidence la passion de son auteur pour Camus et a été saluée chaleureusement par l’assemblée.
M.C.

ACADÉMIE D'AIX
Sciences, agriculture,
arts et belles-lettres

Le mardi 7 novembre 2017,
l’Académie a fait sa rentrée.
Elle a élu son bureau, le nouveau Président étant M. Jean-Jacques Lecomte.
Le mardi suivant, le 14 novembre 2017, l’Académie a entendu
M. Gilbert Schlogel
donner sa communication,
Philippe Mouret, le Français qui a bouleversé la pratique chirurgicale du monde entier.
Cette intervention, alliant l’humour à la rigueur scientifique, a été suivie avec le plus vif intérêt.
L’orateur nous en a fourni un résumé que nous communiquons à nos lecteurs :
« Philippe Mouret est un lyonnais né en 1938 et qui termina ses études de chirurgien en 1966. C’est le moment où ses ainés lui transmirent une technique gynécologique mise au point à Paris et appelée cœlioscopie. Il s’agissait d’explorer la cavité pelvienne féminine avec une fine lunette, donc d’ouvrir le ventre mais par simple incision ombilicale, avant de s’attaquer à des opérations complexes en particulier en cas de stérilité.
Très intéressé par une nouveauté qui ne passionnait pas ses confrères, Mouret commença à pratiquer de petites interventions par cette voie d’abord qui fut bientôt qualifiée de mini-invasive. D’année en année, il perfectionna sa méthode qui permettait aux opérées de quitter l’hôpital au bout de vingt-quatre heures. Il l’étendit bientôt à l’ensemble de la cavité abdominale, traitant des appendicites et des occlusions intestinales, toujours avec de courtes incisions de la paroi, au travers desquelles il passait des instruments de plus en plus sophistiqués.
Jusqu’à l’année 1987 où, après vingt ans de pratique cœlioscopique quotidienne, il osa, sans ouvrir le ventre, enlever une vésicule biliaire malade, au grand étonnement de sa patiente…et de tous ses confrères. Rapidement équipé d’un cœlioscope muni d’une caméra, il multiplia des opérations du même type, provoquant, au sein de sa corporation, des réactions très variées. Quelques praticiens, surtout des jeunes, le félicitèrent et vinrent s’instruire à son contact, mais d’autres, se sachant bien incapables de l’imiter, préférèrent le critiquer publiquement.
En 1990, il décida de quitter un monde hospitalier hostile pour créer un « Centre » privé consacré à cette nouvelle forme de chirurgie ambulatoire. Bien que financé facilement par les banques, il se heurta à une opposition administrative obstinée qui l’empêcha d’y exercer. Finalement désavoué par la justice puis par le Conseil de l’Ordre des Médecins, il dut quitter la France en 2002, pour aller exercer dans un autre pays où on l’accueillerait à bras ouverts. Les Américains s’extasièrent devant cette New French Revolution et les Japonais lui décernèrent en 2007, le prix Honda, qui récompense les innovations bénéfiques à l’humanité.
Malheureusement, un fâcheux cancer vint interrompre cette brillante carrière et Mouret nous quitta en 2008, rassuré par une célébrité enfin acquise en France quand le maire de Lyon lui remis la médaille d’or de la ville. Il n’a malheureusement pas su qu’en 2014 le Conseil de l’Ordre, qui l’avait banni en 2002, inaugura une nouvelle salle en lui donnant son nom. Et les éditions Sauramps de Montpellier acceptèrent de publier sa biographie. Incroyable mais heureux retour des choses. »
M-C.E